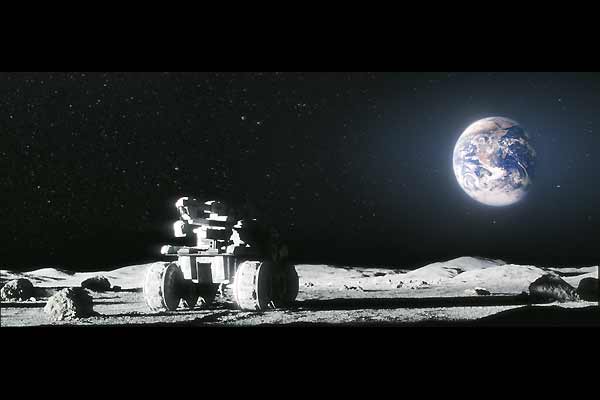MAMMUTH de Gustave Kervern et Benoît Delépine ****



C'est le premier jour du reste de la vie de Serge Pilardosse. Ses collègues "fêtent" avec lui son départ à la retraite puis il se retrouve seul sur le parking de l'entreprise de découpage de porcs où il fut un employé modèle et un bon compagnon. Chez lui il retrouve sa femme Catherine qui s'aperçoit qu'il lui manque des fiches de paie pour prétendre à sa retraite à taux plein. Elle l'encourage à partir à la recherche de ces "trimestres" manquants. Il chevauche sa vieille "Mamut", une moto des années 70 et entreprend un voyage insolite pour récupérer ses fiches de paie, ses "papelards" comme il les appelle. En route, il va faire des rencontres, se souvenir, établir comme un bilan et peut-être réapprendre à vivre au contact d'une nièce un peu barge (Miss Ming, surprenante) et à aimer.
Le film s'ouvre sur ce pot de départ à la fois hilarant et lugubre. Le patron lit sans enthousiasme un texte qu'il n'a manifestement pas écrit pendant que les employés grignotent bruyamment des chips. "Que la fête commence" conclut-il, et c'est sinistre ! On rit, mais déjà, le rire devient jaune et si l'on sourit encore tout au long du parcours de Serge, c'est plutôt les larmes qu'on doit étouffer. Chez lui, entre sa femme qui le harcèle de trouver de l'argent car son salaire à elle ne pourra suffire, et son ennui, Serge tourne comme un lion en cage, compte les voitures qui passent, entreprend le puzzle qu'il a reçu comme cadeau de départ ! Au cours de son voyage on constate qu'il a fait d'étranges boulots Serge (fossoyeur, forain, videur, vigneron...) mais toujours il a travaillé, pour vivre, plus simplement pour survivre. On apprend avec lui que parfois il a été exploité, pas considéré, pas déclaré. Il ne comprend pas tout mais il avance. Ce qui lui faut c'est son "papelard" pour toucher ses sous.
C'est un film unique, inclassable, généreux, politique et digne. Pas de pathos, jamais, ni de misérabilisme mais un spleen immense, une mélancolie tellement considérable qu'elle en devient impressionnante, presque dérangeante. Justement parce que jamais le trait n'est appuyé sur l'adversité ou la détresse de ces laissés pour compte qui s'épuisent au boulot mais restent debout en toute circonstance, sans état d'âme. Et pourtant Catherine (Yolande Moreau, tout naturellement et simplement IMMENSE) dira à Serge "faut que tu trouves de l'argent sinon je vais passer de l'oméopathie aux anti-dépresseurs...", là on rirait presque si elle n'ajoutait "maintenant tu sais, je vais au travail en tremblant". Et ainsi le film oscille sans cesse entre le sourire et les larmes. C'est un film qui palpite avec un coeur qui bat et c'est très beau.
Evidemment, les réalisateurs ne sont pas toujours très regardants sur la qualité de la lumière ou la stabilité de la caméra mais peu importe, cela ajoute encore à l'authenticité de l'ensemble. Et puis quelques gros plans fixes sur le visage de Depardieu et l'on comprend ce que douleur muette veut dire. Il semble ici se souvenir le fabuleux acteur qu'il est. Ou bien alors est-ce parce que pour la toute première fois il est vraiment lui-même en toute simplicité ? En tout cas, depuis Cyrano je crois, je ne l'ai plus jamais vu si aérien, sobre et doux mais aussi démuni, perdu, désorienté ! Malgré l'ampleur de ce corps devenu invraisemblablement gros, cette longue tignasse jaune et filasse, il impose à l'écran une fragilité et une douceur renversantes, sans jamais une seule fois élever sa voix dont on sait à quel point elle peut tonitruer. Sont-ce les réalisateurs qui ont contenu la bête, le monstre, ou est-ce lui-même qui révèle cette lassitude déchirante, cette bonté et ce calme spectaculaires et poignants ? Peu importe, l'essentiel est là, dans ce beau grand film différent qui nous offre sur un plateau un acteur monumental.
Gérard Depardieu forme avec Yolande Moreau, elle aussi à l'apogée de son interprétation, un couple absolument convaincant, crédible et bouleversant. Je ne vous cite aucune des belles scènes, drôles, tendres ou cruelles qui jalonnent le voyage. Je vous les laisse découvrir ainsi que les acteurs qui offrent chacun un moment unique à chaque étape. Par contre, je ne peux m'empêcher d'évoquer celle qui par intermittence vient poser sa tête sur l'épaule de Serge/Gérard, elle, l'ange gardien, la première femme aimée, celle qui laisse inconsolable et qui murmure des mots d'amour de sa voix miraculeuse, Isabelle Adjani...
....................................................
Vous autres "face-bookés", n'hésitez pas à défendre ce film ICI.