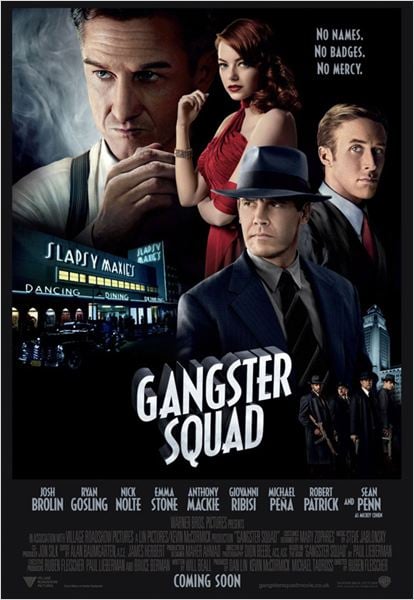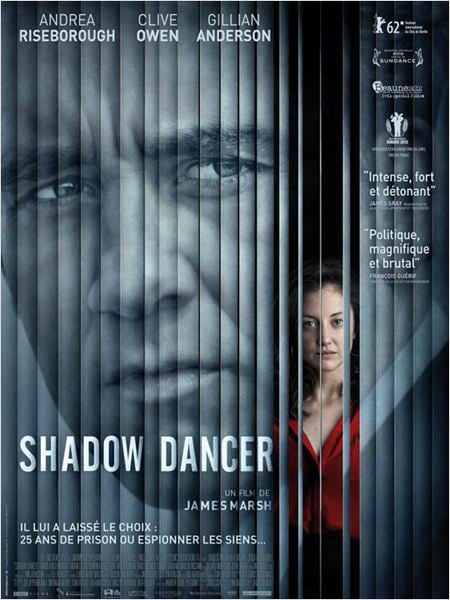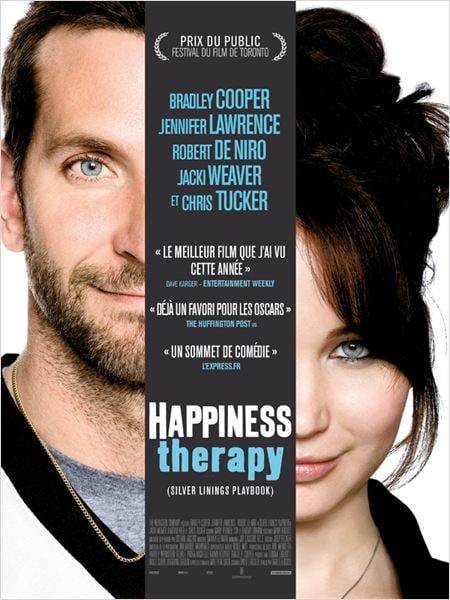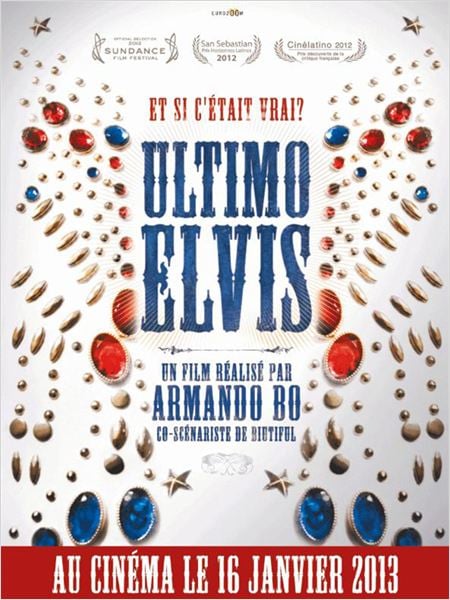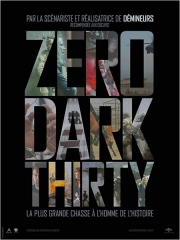Les 4 derniers mois de la vie d'Abraham Lincoln, 16ème Président des Etats-Unis et premier à avoir été assassiné. En 1865, il vient d'être réélu pour un second mandat. Il est confronté à la guerre de Sécession qui fait rage et déchire le pays depuis 4 ans et à laquelle il veut mettre un terme. Le Nord abolitionniste s'oppose au Sud conservateur notamment sur la question de l'esclavage des noirs. Lincoln va mettre toute son énergie et sa détermination pour faire accepter le XIIIème Amendement de la Consitution des Etats-Unis d'Amérique, abolir et interdir l'esclavage et toute servitude involontaire.
Pour cette noble et légitime cause, Lincoln va faire preuve d'un courage et d'une fermeté sans faille. Il ira jusqu'à faire du porte à porte pour recueillir les dernières voix qui manquent et il semble que l'amendement ait été adopté avec une majorité de seulement deux votes ! Difficile d'entretenir un quelconque suspens avec un événement dont on connaît l'issue et à ce titre la scène du décompte des voix est assez ridicule. La musique de John Williams s'enfle jusqu'à l'explosion comme si le moindre doute subsistait. Spielberg sait-il que nous sommes en 2013 et qu'on sait que l'esclavage est aboli ?
Néanmoins, ce film est parfait. Oui, parfait. Mais trop. Trop de tout. Trop long. Trop didactique. Trop répétitif. Les mêmes scènes se renouvellent tout au long de deux heures trente interminables où toute une ribambelle de personnages, de noms nous sont imposés sans qu'on comprenne toujours qui est qui et qui fait quoi. A ce titre Tommy Lee Jones (bravo pour la moumoute, il peut remercier le perruquier, c'est un marrant !) dans le rôle de Thaddeus Stevens (jamais entendu parler !) est très représentatif. Au début on est absolument persuadés qu'il est un opposant à Lincoln et ses aberrantes idées progessistes. Or, on découvre un peu plus tard qu'il est un ardent défenseur de l'abolition de l'esclavage à laquelle il travaille depuis trente ans ! Il faut dire que les nombreux dialogues et tirades ampoulées, pompeuses et théâtrales mériteraient la plupart du temps d'être réécoutées une seconde fois pour en saisir toute la finesse, ou au moins le sens. Car Lincoln est un film bavard, très très bavard. Et Lincoln le personnage est un homme bavard. Tout comme ses collaborateurs, on finit par se lasser de ses petites histoires métaphoriques et tortueuses dont il a le secret. Lincoln est incapable d'appeler un chat, un chat. Pour lui c'est un Felis silvestris catus, un mammifère carnivore de la famille des félidés. Et c'est fatigant tout ce verbiage grandiloquent souvent injustifié.
Oui ce film est fatigant. Et très laid aussi. En 1865, il n'y avait pas l'électricité. Tout se passe donc dans une semi-obscurité, dans des teintes grisouilles et verdâtres donnant à l'ensemble une image très moche, boueuse, craspec comme la sale guerre qui fait rage. Il n'y avait pas le chauffage central non plus et on se les caille menu à la Maison Blanche.
Lincoln est un type bien, un grand Président, un orateur hors pair, un stratège exceptionnel. Il était aimé, adulté, respecté. Mais Spielberg en fait un saint, une icône figée dans un seul et unique combat qui l'épuisera. Le général Grant, fin psychologue, lui dira d'ailleurs "je vous ai vu l'année dernière, vous avez pris dix ans". Il est vrai que Lincoln a une cinquantaine d'années et ressemble à un vieillard. Il faut dire que sa vie privée est pour le moins tumultueuse aussi et qu'il doit gérer son instable, cyclothymique et autoritaire femme Mary, inconsolable depuis la mort d'un de leur fils et se bagarrer pour que Robert leur fils aîné ne s'engage pas dans l'armée.
Lincoln est donc un film qui se regarde être LE film politique ultime mais dont on sort en se disant "sitôt vu, sitôt oublié" avec néanmoins (je ne suis pas à une contradiction près) l'envie d'en savoir plus sur ce personnage, sa vie, son oeuvre ! Et puis il y a Daniel Day Lewis, acteur sublime dont chaque rôle est toujours un événement d'autant plus estimable qu'il est rare. L'humour, la douceur, l'humanité, l'intelligence, la fermeté de son personnage déferlent sur l'écran avec une évidence, il EST Lincoln. Pourquoi a t'il fallu qu'on lui ajoute numériquement des échasses pour le faire paraître immense (Lincoln atteignait presque les deux mètres), ses jambes ressemblent du coup à deux bâtons et lui mettre une tonne de farine sur le visage pour le faire paraître fatigué ?
Lincoln est un film bizarre, prétentieux, fatigant, à la fois trop grand et comme s'il n'était que le brouillon de ce qu'il aurait dû être.
Pfiou, je vais dormir un peu...